Suehiro Maruo est réputé pour être un maître de l’ero-guro (l’érotisme grotesque) à l’imagination sans limite. Nous avons frémi aux spectaculaires horreurs de L’île panorama et Le Diable en bouteille tout en sachant que les monstres qui les hantent sont d’abord des démons de l’esprit. Paraiso, célébrant les quarante ans de carrière du mangaka, dévoile une autre facette de son art : ici, l’horreur est ancrée dans le réel et prend pour cadre le Japon ravagé par les bombardements et l’immédiate après-guerre. Elle ne nait plus de fantasmes macabres délirants mais d’une approche historique et documentaire, et s’exerce en premier lieu sur les enfants, éternelles victimes de la cruauté des hommes.
Le Japon d’après-guerre : le crépuscule des dieux
Le Tokyo des années trente était une cité prospère, ouverte au progrès et l’un des foyers intellectuels et artistiques de l’Asie. La guerre en a fait un champ de ruines où tente de survivre un peuple en haillons. Les hommes reviennent mutilés ou traumatisés, les orphelins sont livrés à eux-mêmes, et de très jeunes filles se prostituent. Dans ce chaos, rodent des prédateurs prêts à tout pour en tirer profit, aussi bien économiquement que sexuellement ou idéologiquement.
Les ruines du pays étaient autant matérielles que spirituelles. La capitulation d’Hirohito le 15 août 1945 s’était accompagnée d’un renoncement à sa nature divine. Lorsque le Japon s’ouvrit à l’Occident pendant l’ère Meiji (1868-1912), l’empereur fut placé à la tête de la nation pour en assurer l’identité. Sa divinisation était la clé de voûte d’une puissante opération de propagande visant à en faire le descendant direct d’Izanagi et Izanami, les divinités fondatrices du Japon. Dans les manuels des écoliers, cette généalogie n’était pas enseignée comme une allégorie mais comme un fait historique. Mourir pour la patrie, en projetant son avion sur les navires américain, participait d’une dévotion quasi mystique au souverain. La défaite laissa donc les Japonais désemparés, et en fit littéralement un peuple sans dieux. Pour survivre, ils allaient devoir adopter les mœurs de l’occupant américain dont le but était de « déféodaliser » leur pays et le transformer en une nation moderne, démocratique, accordant entre autres le droit de vote aux femmes.
Fallait-il pour autant rejeter tout de l’ancien Japon, et en particulier les cultes shintos et bouddhistes, désormais entachés de crimes de guerre ? Le catholicisme allait-il devenir, comme souvent, l’instrument d’une acculturation ? Dans une case de Paraiso, la tête d’un Bouddha décapité est effondrée au milieu des ruines comme l’annonce de la chute des anciens dieux. Le prêtre qui traverse ce paysage pense : « Le Bouddhisme est une religion de barbares. Seul le catholicisme détient la vérité. Les Japonais finiront par devenir les serviteurs de Dieu. »
La religion chrétienne n’était pas étrangère au Japon : au XVIIe siècle, des jésuites portugais, basés à Nagasaki, menèrent une mission d’évangélisation. La répression des catholiques japonais par les shoguns, l’une des plus violentes de l’histoire, est relatée dans le film Silence(2016) de Martin Scorsese d’après le roman de Shusaku Endo.
Maruo ne résume pas toute l’horreur de l’époque au seul Japon. Paraiso s’achève en Pologne avec deux récits : Monsieur le Hollandais et La Vierge Marie, narrant le martyre du légendaire Maximilien Kolbe. Ce frère franciscain, fondateur en 1931 du Jardin de l'Immaculée près de Nagasaki, retourna en Pologne et fut déporté à Auschwitz en 1941. Ayant pris la place d’un prisonnier condamné à mourir de faim et de soif, Kolbe aurait survécu trois semaines grâce la prière, avant d’être exécuté avec une piqure de phénol. Dans Monsieur le Hollandais, l’esprit miséricordieux de Kolbe incite un jeune garçon à se montrer charitable avec les blessés d’un bombardement.
Dans La Vierge Marie, c’est une image de la Vierge, offerte par un déporté dessinateur de bandes-dessinées, qui aide Kolbe à transcender son martyr. Ainsi, c’est le dessin lui-même qui fait office de relique sacrée. On peut-y lire la profession de foi de Maruo envers la bande-dessinée qui, pour l’enfant turbulant et un peu délinquant qu’il était, fit office de rédemption. Dans Paraiso, la seule évasion des enfants hors de ce monde de terreur est la lecture de Lost World, le manga d’Osamu Tezuka inspiré de Conan Doyle.
Entre néo-réalisme et surréalisme
Maruo absorbe les références cinématographiques ou littéraires pour nourrir son œuvre. Dans Paraiso, il puise au cinéma néo-réaliste né en Italie au sortir de la guerre.
La première case de Vagabonds de guerre compare les ruines de Tokyo à celles de Berlin. « Tokyo est minable jusque dans ses ruines » écrit Maruo. Ces visions d’une ville ravagée et de ses enfants perdus évoquent Allemagne année Zéro (1948) de Roberto Rossellini et la destinée tragique du petit Edmund dans le Berlin d’après-guerre. Les pickpockets juvéniles rappellent ceux de Paisa (1946) : un GI se faisant dérober ses rangers par un enfant romain découvrait que ses parents avaient péri sous les bombardements alliés. Le Tokyo de 1949 a trouvé une représentation saisissante dans Chien enragé (1949) de Kurosawa où un policier traverse les quartiers de bidonvilles et son peuple de damnés. Un même néo-réalisme est à l’œuvre dans la littérature japonaise d’après-guerre et le mouvement de la « littérature de la chair ». Dans L’Idiote(1946), Sakaguchi Ango décrit une passion animale dans une ville enflammée par les bombes et La Barrière de chair de Taijiro Tamura (1947- adapté par Seijun Suzuki en 1964) documente la vie des prostituées racolant dans les décombres. Ce courant littéraire moderne, violent et transgressif, attaquant tous les tabous tels que l’inceste, le sadomasochisme, le cannibalisme ou la défiguration, alimente l’horreur réaliste de Paraiso. La critique d’une religion corrompue avec ses curés dissimulant leurs perversions sous leurs soutanes entraîne Maruo du côté du cinéaste surréaliste Luis Bunuel.
Le récit Diabolique présente un curé pédophile aux allures de démon. Lorsque des mendiants s’introduisent dans l’orphelinat pour festoyer, se déguisent en religieuses et parodient la Cène, Maruo reproduit la célèbre orgie blasphématoire de Viridiana(1961). Quant aux bandes d’enfants, elles rappellent celles des quartiers de pauvres de Mexico dans Los Olvidados (1950). Luis Bunuel et Maruo partagent la même cruauté dans cette image brute, et parfois hallucinée, d’une enfance perdue entre délinquance et maisons de correction.
Une comédie inhumaine
Parallèlement au néo-réalisme, Maruo ne délaisse pas l’ero-guro qui a fait sa réputation.
Maruo poursuit certaines de ces obsessions telle l’androgynie avec ses garçons et filles aux physiques neutres, facilement interchangeables. La petite Tarô dans Vagabonds de guerre se fait passer pour un garçon, sans doute pour éviter de se faire violer. Parallèlement, dans Dodo l’enfant do, un garçon se travesti en marchande de fleur, pour mieux vendre sa marchandise. La crise d’identité que connait alors le Japon perturbe également les genres. Personne n’est vraiment ce qu’il parait.
La culture de Maruo dans le domaine de l’horreur, autant au théâtre qu’au cinéma, est foisonnante. Dans le terrifiant Dodo l’enfant do, une créature au visage mutilé, vêtue de noir et tenant un bébé dans les bras, hante les décombres. Son origine obscure en fait une légende urbaine semblable à la fameuse « femme défigurée » des années 1980. Les rumeurs circulent parmi les enfants : était-elle l’épouse d’un professeur d’université, une professeure de shamisen ou la patronne d’un restaurant ? Son visage au nez tranché lui donnant l’apparence d’une tête de mort s’inspire du maquillage de Lon Chaney dans Le Fantôme de l’opéra (1925) de Rupert Julian. Lorsqu’elle suce le doigt blessé d’un enfant, elle reproduit le geste du Nosferatu (1922) de Murnau. Le bébé momifié qu’elle transporte en fait une mère d’outre-tombe, telle Oiwa-san le plus célèbre des fantômes féminins du kabuki, à l’origine du cinéma d’horreur japonais et qu’interprète la mère des enfants dans Tomimo la maudite. Cette créature nous l’avions aussi croisée dans Vampyres : l’ogresse dont la bouche carnassière était calquée sur celle d’Hanya la démone du théâtre nô.
Ce ne sont pas les seules auto-références dont Maruo parsème Paraiso. Sayo Matsumoto, la petite fille abusée par un prêtre dans Diaboliqueressemble comme deux gouttes d’eau à Tomimo. Dans Paraiso et Tomimo la maudite, un même vieillard à la barbe blanche a pour mission d’attirer les enfants dans un orphelinat catholique. Dans les deux mangas, les jeunes héros ont des visions hallucinées du martyre des premiers chrétiens de Nagasaki. Comment se nomment d’ailleurs les derniers chapitres de Tomimo la maudite ? Tout simplement Paraiso. Se recoupant sans cesse, les œuvres de Maruo forment une véritable comédie inhumaine du Japon.
Le peintre des enfers
En quoi le style de Maruo a-t-il changé au cours de ses quarante ans de carrière ? Dans La Jeune fille aux camélias, Yume no Q-saku ou Le Monstre au teint de rose, ses décors étaient stylisés comme sur une scène de théâtre. Son art s’exerçait alors sur les phénomènes de foire et les créatures baroques. La composition même des maisons japonaises, avec leurs tatamis, futons et cloisons de papier, inclinait à cette théâtralité. Pourquoi élaborer des architectures complexes alors que le centre du récit était une inimaginable chenille humaine ? Au fil du temps, le dessin de Maruo a gagné en rondeur, l’éloignant de la violence viscérale de ses premières planches où sa plume semblait griffer cruellement la feuille de papier. Sa technique s’est évidemment enrichie et les cases éparses de villes, reproduites d’après des photographies d’époque, ont laissé place à de vastes panoramas. L’un des jalons de l’appropriation du décor par Maruo est d’ailleurs L’Île panorama où il élabore un vertigineux paysage, une végétation luxuriante et des édifices au-delà de la raison. Peut-être fallait-il à Maruo un décor qui soit lui-même un monstre décadent pour l’amener à élargir son champ de vision. Dans L’Enfer en bouteille, l’île grouillantes d’insectes, de créatures marines et de fruits exotiques est également un espace mental : l’expression de l’amour incestueux du frère et de la sœur. Tomimo la maudite rappelle La Jeune fille aux Camélias mais le récit est cette fois contextualisé : le quartier des théâtres d’Asakusa pendant les années 40, avec ses façades et banderoles est désormais restitué avec une précision maniaque. Les personnages, toujours aussi insolites, sont désormais intégrés au Japon et à son histoire. Paraisoest l’accomplissement de cette mue : de fantasmagorique, l’art du mangaka est devenu documentaire. Les grandes planches éclatées où il lâchait la bride à son imaginaire érotique laissent place à un découpage plus classique. Nous sommes rivés au sol avec les personnages et traversons un monde littéralement dantesque et clos sur lui-même, qu’il s’agisse de Tokyo ou du camp d’Auschwitz : cet enfer sur terre, est la création de l’homme lui-même, et Maruo devient son peintre halluciné, tel un Jérôme Bosch des temps modernes.






























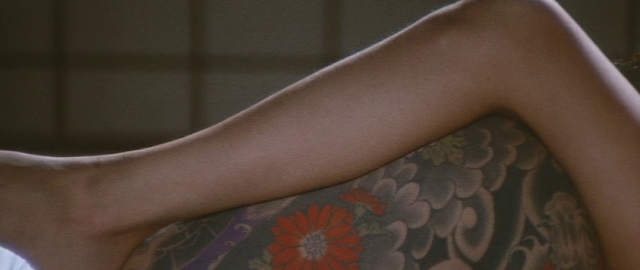







































































































































































































































































%20%5BHD%20Upgrade%5D%20-%20YouTube.png)
%20%5BHD%20Upgrade%5D%20-%20YouTube.png)
%20%5BHD%20Upgrade%5D%20-%20YouTube.png)





































































































































































































































































